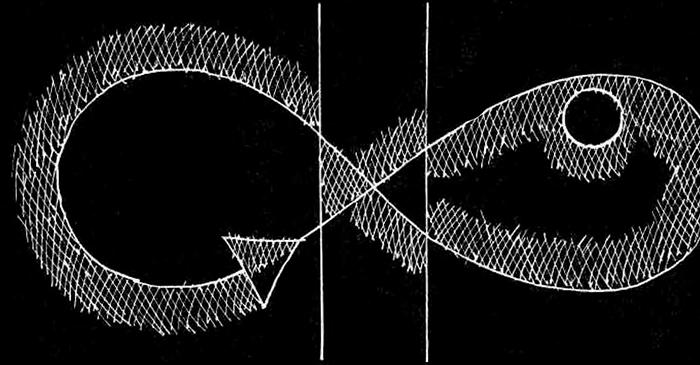Je m'appelle René Lourau. Je suis actuellement professeur de sociologie à l'Université Paris VIII-Vincennes, c'est-à-dire une université qui a débuté en 68 à Vincennes, et où déjà depuis pas mal de temps je travaille dans un courant de recherche qui s'appelle "l'analyse institutionnelle", qui a un rapport étroit avec l'autogestion et avec les idées libertaires dans la mesure où c'est l'analyse de l'état et la critique de l'état qui est au centre de tout cela.
J'ai donc un peu appris ces choses-là en 68: j'étais alors étudiant d'Henri Lefèvre à l'université de Nanterre. On sait que beaucoup de choses en 68 ont commencé dans notre département de sociologie où il n'y avait pas seulement des enseignants comme H. Lefèvre ou Jean Baudrillard et moi(?). Il y avait aussi des étudiants comme Cohn-Bendit ou Duteil et quelques autres.
68, pour moi, n'est donc pas un symbole, c'est une réalité.
C'est vrai que, pour beaucoup de carcans politiques, idéologiques, c'est un symbole. Une des choses qui m'a frappé en 68 c'est qu'un certain nombre de courants de pensée politiques y voyaient la réalisation de leurs idées: c'était même un thème un peu amusant, on en faisait beaucoup de plaisanteries. Les anarchistes disaient "c'est une révolution anarchiste -en quoi, je crois, ils avaient raison, mais de là à dire que c'était leurs idées à eux, leur militance à eux qui avaient abouti à cela, il y avait peut-être quelques nuances à apporter, puisque c'était un mouvement beaucoup plus large, et effectué par des gens, jeunes ou moins jeunes, qui n'avaient jamais entendu parler, parfois, de l'anarchie!-. Les surréalistes, avec lesquels j'étais assez lié à l'époque, ont dit aussi: "c'est la révolution telle qu'on la demande depuis 1925". Les situationnistes ont dit: "Oui, c'est une révolution situationniste". Tous ont un peu raison et tous ont un peu tort.
Il y a donc une partie symbolique (je n'aime pas ce mot parce qu'on utilise le terme "symbole" pour ne pas parler de la réalité): des mouvements politiques, avangardistes ou culturels ont parlé de symbole, peut-être parce qu'ils n'étaient pas, ou plus tout à fait, dans la réalité, moi, j'avais la chance (mais je n'étais pas le seul, je n'ai aucun privilège) d'être à Nanterre, en sociologie, où beaucoup de choses se sont passées qui ont donné naissance au mouvement étudiant de 68. J'étais également dans un courant de praticiens et de chercheurs en autogestion pédagogique, c'est-à-dire que j'expérimentais -je ne me contentais pas d'écrire là-dessus-: nous étions quelques-uns à expérimenter des choses qui étaient très oppositionnelles et très déplaisantes pour l'institution dans les établissements scolaires où nous étions. En même temps, nous réfléchissions dessus, nous diffusions l'idée d'autogestion à partir de l'autogestion pédagogique.
Dans notre courant, il y avait, avant même 68, une forte volonté d'aller dans le sens de ce qu'allait être le mouvement de 68, surtout, je le souligne, sur le plan politique, car l'avant-68 était alors une période de dépolitisation, comme on le voit actuellement. Nous faisions partie, en France et dans le monde, aussi bien en Italie qu'ailleurs, des rares personnes qui militaient activement pour l'autogestion. Or c'est là, je crois, une des idées qui est sortie du mouvement de 68 et pas seulement dans l'éducation. Cette idée n'était pas absolument nouvelle puisqu'elle avait été pratiquée par les républicains espagnols en 36-38 et par d’autres mouvements anarchistes, en Ukraine, etc., mais c'était en France une idée qui apparaissait nouvelle parce que l'oubli avait déjà fait son œuvre, bien sûr.
Une autre chose m'a frappé, en 68, dans la politique même du mouvement: très vite, nous les enseignants avons été du même côté de la barricade que nos étudiants, même si statutairement nous étions différents, bien entendu, ce sont ces formes sociales réinventées. Je dis réinventées parce qu’il n'y a jamais d'inventions pures et simples dans l'histoire, mais comme il y a des périodes d'oubli, qui peuvent être plus ou moins longues, on a l'impression de découvrir des formes sociales de révoltes qui en fait ont toujours existé d'autant que l'histoire nous en parle depuis des millénaires, dans l'histoire connue.
Avec ces formes, c'est l'Assemblée Générale, la fameuse AG qui a beaucoup influencé mes recherches et celles de mes amis de l'analyse institutionnelle, puisque nos interventions sont basées sur cette mise en place, toujours difficile et presque impossible... l'Assemblée Générale des gens sur qui nous intervenons, c'est-à-dire une collectivisions du savoir de l'institution... J'ai donc beaucoup appris dans les AG de 68, que ce soit à Nanterre, à la Sorbonne, à l'Ecole d'Architecture, dans l'Institut Pédagogique, dans beaucoup d'autres lieux: c'est vraiment la forme qu'on retrouve dans tous les moments chauds de l'histoire, pour citer l'exemple français (mais il n'y a pas que la France): à la Révolution, de 89 à 94 (à Thermidor), tout est scandé par des Assemblées Générales soit officielles, soit officieuses, qui déterminent vraiment le cours de l'histoire.
L'autre forme, c'est la manifestation, sans doute encore plus ancienne comme forme que l'AG, mais c'est vrai que mes jambes s'en souviennent: c'est vraiment un souvenir qu'on a dans les pieds et les jambes, avoir marché presque tous les jours pendant des dizaines de kilomètres avec des amis, connus ou inconnus. Et cette forme très très physique d'opposition modifiait aussi tout le paysage urbain, produisait une convivialité inouïe, on peut dire, là vraiment, tout à fait inconnue, y compris avec des gens qui restaient sur les trottoirs pour regarder passer la manif. Voilà encore un souvenir qu'on peut dire sociologique mais je crois que tout le monde était sociologue et que tout le monde pouvait ressentir ce qu'il y avait d'extraordinairement libérateur et libertaire dans la forme qu'avaient les AG et les manifestations de rue. Voilà donc deux choses qui m'ont profondément marqué, pour toute la suite de ma carrière. Et puis bien sûr il y a la grève.
J'aimerais développer un troisième élément (il y en aurait encore beaucoup d'autres): c'est le fait que nous n'avons pas été conscients tout de suite du fait qu'il s'agissait d'un phénomène qui n'était pas que français. Nous avions, bien sûr, des informations sur ce qui s'était passé aux Etats-Unis depuis 66, tout le mouvement de contre-culture né en partie de la contestation politique contre la guerre du Vietnam, de ce qui s'était passé en Allemagne depuis l'année précédente. Je me souviens encore avoir pris un train de banlieue de Saint-Lazare jusqu'à Nanterre-la-Folie (c'était le nom de la station de l'université, c'est comme ça!) avec Daniel Cohn-Bendit qui venait de rentrer d'Allemagne, quelques semaines avant que ne se déclenche vraiment le mouvement; il m'a raconté: il avait rencontré Dutschke et me racontait ce qui se passait et qu'on connaissait mal parce que les journaux ne s'en faisaient pas tellement les échos en France: nous savions que les allemands avaient déjà, au niveau universitaire et sans que cela ne s'étende (comme en France au niveau de presque toute la classe ouvrière), fait des choses qui allaient contre l'institué, enfin une contestation de ce qui était déjà là, de ce qui était constitué, ce qui est pour moi l'essence même de la pensée libertaire ou anarchiste. C'est peu après, enfin parfois plus tard, qu'on s'est aperçu que c'était un mouvement vraiment mondial: on a su les formes qu'il avait prises au Japon avec les Zengakuren et où c'était certainement plus militariste, au Mexique où il y a eu plus de 200 morts sur la Place des Trois Cultures: là, ce n'était pas militariste, les militaires, c'était le gouvernement, ce sont eux qui ont massacré les gens. Et l'Italie et bien d'autres pays d'Europe, de tous les continents d'ailleurs, même dans certaines universités africaines. On ne le savait pas alors mais on l'a su depuis, qu'il s'était passé bien des choses-là, ainsi que dans des universités asiatiques autres que celles du Japon, et également en Amérique Latine...
Il s'agissait là un peu, je pense, pour la première fois depuis les révolutions de 1848, sans parler de celles de la fin du XVIIIème siècle (Etats-Unis, France, Suisse, Hollande, Belgique, Italie, etc.), d'une prise de conscience de ce que nous n'étions pas seulement des français en train de manifester contre De Gaulle cl le gouvernement (ce qui est une vieille attitude française) mais que, sans que nous le sachions ni qu'on puisse encore aujourd'hui analyser les causes planétaires de cela, nous faisions partie d'un mouvement beaucoup plus large.
Moi, cela me rassure, je veux dire: je suis encore plus heureux de savoir que nous avons participé à un mouvement de portée planétaire, plutôt que d'agiter des souvenirs purement français sur un mouvement qui aurait été purement français.
C'est vrai que cette critique un peu sociologique est une certaine interprétation d'un Mai français qui, en réalité, n'était pas isolé: je lais allusion à un phénomène qui intéresse aussi les sociologues et les philosophes c'est-à-dire au rôle de l'imaginaire, de l'imaginaire social, qui a été étudié en particulier par Castoriadis et à sa suite par d'autres. Il est certain que non seulement après on a reconstitué un imaginaire qui était moins "roman familial", moins fantasmé, de ces mouvements mondiaux, mais pendant ceux-ci et même avant d'ailleurs, parce qu'il y a toujours un avant, l'idée d'un renversement des valeurs de ce que nous appelons l'institué était très fort dans beaucoup d'esprits, pas seulement des étudiants ou des groupes avangardistes, artistiques, culturels, anarchistes, etc. En l'absence, ici, de toute idéologie précise -ce que regrettaient d'ailleurs les politiciens, en particulier les communistes et les marxistes, en l'absence -et Dieu merci- d'une idéologie conductrice et d'un état majeur (parce que ça va ensemble), et d'un parti dominant (parce que ça va ensemble) sur le mouvement, il faut bien accepter l'idée qu'il y avait, à cette époque, créée par des conditions qu'il serait trop long d'analyser, toute une production d'imaginaires sur la société telle qu'elle était, telle qu'elle ne devait pas être, telle qu'elle pourrait être, mais sans qu'il n'y ait -sauf dans les groupuscules les plus institués de type trotskyste, marxiste- le programme "clefs en mains" d'une société de remplacement, comme on a une voiture de remplacement lorsqu'on a un accident et qu'on a une bonne assurance...
Cela, c'est, je crois, l'une des choses les plus belles, les plus magnifiques du mouvement de 68: c'est que l'imagination a été vraiment au pouvoir, comme l'indique l'un des plus fameux slogans du mouvement, puisqu'il n'y a pas eu de prise de direction politique de ce mouvement, malgré les tentatives de celles de Mitterand et de Mendès-France qui ont misérablement raté, et il ne pouvait pas y en avoir: cela, c'est la spécificité, la singularité de 68 car dans l'histoire passée je ne vois pas, enfin à priori, des mouvements du même type qui aient réussi à évacuer, et en douceur peut-on dire (Mendès-France a été sifflé, évacué du stade Charletty lorsqu'il a essayé de se mettre en avant; Mitterand ne s'est même pas montré tellement il était sans doute peu confiant dans la possibilité de donner une direction politique): c'est vraiment l'originalité sociale, sociologique, du mouvement de 68, ce fait que pendant quelques semaines au moins l'imagination a pris le pouvoir, même si elle a dû céder la place, dès les élections de fin juin, à la "dure réalité" qui, en fait, n'était pas la réalité mais tout simplement l'imagination de la peur, celle de la France profonde qui avait envie de revenir à l'ordre et qui a donné une majorité complètement inattendue à la droite à l'Assemblée Nationale française. Mais je pense que ce n'est pas grave qu'il n'y ait eu que quelques semaines, pour les gens qui l'ont vécu, comme pour ceux qui, sans l'avoir vécu directement, en ont eu des témoignages, parce que c'est sûrement un des plus grands laboratoires historiques, en tout cas du XXème siècle, dans le monde occidental et en dehors de lui. C'est pour ces raisons-là, cette invention/réinvention des formes et cette place donnée à l'imagination qui, sans violence, arrivaient à rendre inexistantes ou insignifiantes les tentatives de récupération soit idéologiques -celles-là n'ont pas manqué- soit surtout politiques (celles de Mitterand et de Mendès-France).
Pour faire l'histoire, il y a un écueil qui se présente, c'est l'illusion d'optique. On a souvent l'impression que c'est en 68, en gros en Mai-Juin pour la France du moins, que beaucoup de choses, transformant profondément les rapports sociaux dans les décennies suivantes, ont été produites dans la durée même du mouvement, au sens où je l'ai décrit, c'est-à-dire au travers des AG, des manifestations de rue et de la grève générale, bien sûr (qui est quand même l'essentiel)!
En fait, il y a une temporalité de la transformation révolutionnaire, et c'est là où l'on voit que cet évènement a été révolutionnaire bien au-delà de ses formes, qui sont bien des formes révolutionnaires (AG, manif, grèves). Il vaudrait mieux dire que les AG, les manifs et les grèves sont des formes "prérévolutionnaires", car cela n'entraîne pas nécessairement une transformation des mœurs, c'est-à-dire de vraies transformations politiques, et pas seulement dans le personnel dirigeant, comme le pensent naïvement les gens de la gauche institutionnelle (tels que Mitterand ou Mendès-France).
Cela, ça s'est produit rapidement, c'est vrai, mais pas sur le moment même.
Sur le moment même, c'est-à-dire pendant les semaines insurrectionnelles, bien sûr les rapports aient changé (sans doute les jeunes étudiants bourgeois de Nanterre, dormant deux heures entre deux manifs dans des maisons inconnues ont découvert ou inauguré par-là d'autres rapports sociaux), mais ce qui a vraiment marqué les décennies suivantes a été une conséquence qui est apparue dans les mois qui ont suivi la période insurrectionnelle elle-même: c'est vrai pour le mouvement de libération sexuelle en général, qui avait été préparé par le mouvement et l'influence de sociologues ou de philosophes de l'Ecole de Francfort ou qui restaient aux Etats-Unis, comme Marcuse. C'est vrai plus particulièrement du mouvement de libération des femmes qui a surtout surgi en 69/70 et les années suivantes. Même chose pour le mouvement des homosexuels. Bref des phénomènes entièrement nouveaux et inconnus jusque-là mais qui apparaissaient parce que quelque chose avait servi de déclencheur qui avait libéré l'imaginaire social, comme dirait Castoriadis. C'est vrai que l'imagination c'est comme l'émotion et le raisonnement: il faut qu'il y ait de grands évènements de foule, des évènements sociaux qui produisent ce déclic, cette autorisation, cette idée qu'on peut penser autrement.
En ce sens, les mouvements idéologiques libertaires, avangardistes comme ceux que j'ai nommés (surréalistes, situationnistes et d'autres), avaient, sinon préparés les esprits des masses -il ne faut pas se l'arc d'illusions-, au moins bien accompagné le mouvement pendant les quelques semaines de son existence. Mais on ne peut pas dire que l'idée de la libération de la femme (et celle de la libération de l'homme par la même occasion), de la libération sexuelle, aient fait partie du programme de la FA en France, ou de celui des surréalistes ou de celui des situationnistes. D'ailleurs ces deux derniers mouvements se sont dissouts en 69 après que l'évènement ait produit ces libérations. Ils ont tellement perçu qu'en même temps que cela se réalisaient ils étaient dépassés (c'est le côté terriblement hégélien de 68) que leur logique (que je reconnais et que j'admire) a fait qu'ils se sont auto-dissouts alors que d'autres mouvements, eux, ne l'ont pas fait.
Il pouvait donc y avoir une influence de ces mouvements, mais je pense que c'est l'effet émotionnel de ces semaines, où des formes sociales nouvelles sont devenues tout à fait légitimes contre la vie quotidienne grise, contre le travail habituel: puisqu'il y avait une grève générale, il y avait non-travail dans une grande partie de la population. Tout cela a produit un choc à la fois intellectuel et émotionnel qui permet de comprendre comme conséquence, et non comme mot d'ordre du mouvement lui-même (parce qu'une fois de plus ce n'était pas là du tout le mot d’ordre des groupes, même des plus avant-gardistes et des plus présents), cette naissance de mouvements qui ont, dans la longue durée cette fois-ci, sur 30 ans ou presque, changé beaucoup de choses dans les rapports sociaux, rapports homme-femme, rapports sexuels, relations avec les homosexuels, rapport dans le couple hétérosexuel ou homosexuel.
Ce n'est vraiment pas comme dans une jolie histoire où tout est produit en même temps: c'est ce que nous appelons un analyseur, un évènement qui oblige tout le monde, sans tenir compte des différences de culture, de connaissance ou même d'appartenance politique ou idéologiques, à faire travailler ses méninges, à libérer ses petites cellules grises: à faire que l'imagination ne soit plus prisonnière...
30 ans après, il est difficile de faire le bilan. J'ai essayé de montrer que 68 n'était pas une révolution comme les autres: elle ne s'est pas produite ni déroulée comme les autres. Finalement, elle a eu des conséquences beaucoup plus importantes que les révolutions "homologuées" dans l'histoire, puisque celles-ci correspondent à un changement de personnel politique, c'est-à-dire débutent un processus d'institutionnalisation: le négatif intervient, comme Max Weber et Hegel l'ont si bien montré, c'est-à-dire que l'on assiste à une espèce de reniement, mais orchestré, programmé du projet révolutionnaire initial. Bien sûr, beaucoup d'acteurs de 68 ont rallié cette institution néo-libérale qui a commencé à se manifester dans les années 1970 (très peu de temps après 68) pour des raisons économiques, mondiales, etc. Mais dans aucun pays, pas seulement en France, il n'y a eu de processus d'institutionnalisation via une doctrine officielle et un changement de personnel politique. C'est là une fois de plus une grande originalité. De cette originalité vient la difficulté d'établir un bilan de 68 comme on le ferait de la révolution d'Octobre 1917 (c'est à la mode actuellement), ou de la révolution de 1789, qu'on appelle française mais qui était déjà une révolution européenne et mondiale.
J'aurais aussi tendance à ne pas répéter avec tout le monde que l'héritage de 68 a été culturel. Je n'en suis pas sûr, parce que la culture est quelque chose qui change très souvent, qui a une temporalité assez saccadée, rapide, sujette à des modes. De plus je n'aime pas du tout la notion de culture qui est une notion de sauvage (?) puisque ça consiste à rejeter les autres cultures. Il y a eu disons, dans le domaine culturel, mais sans trop insister sur le terme, des changements profonds. Ce n'est pas pour rien que beaucoup d'artistes ont été impliqués dans le mouvement. On se souvient de l'occupation de l'Odéon de Jean-Louis Barrault. Il y a eu, là aussi, ce que j'appelais une "autorisation", une liberté donnée à l'imagination.
Finalement, c'est le programme anarchiste depuis toujours à mon avis, et que peut-être Bakounine avait senti parce qu'il avait beaucoup d'imagination et je crois de sens esthétique; cela n'était pas central dans tous les programmes anarchistes de par le monde, mais c'est cela qui s'est finalement réalisé. Je crois que la vie artistique, qu'on appelle culturelle, mais surtout artistique (parce que dans le domaine de la littérature on en voit beaucoup moins de traces) reste aujourd'hui largement tributaire de ce tremblement de terre de 68.
Enfin c'est très important, et pour moi il y a des choses au moins aussi importantes et peut-être plus importantes: il y a eu vraiment une mutation dans l'imaginaire, dans les mentalités, comme on disait autrefois dans la vieille psychologie des foules, et il y a un phénomène que je crois irréversible, même s'il est recouvert par beaucoup de réactions, de restaurations, de récupérations: 68 reste un repère, un excellent repère par rapport à des choses qui n'étaient pas du tout présentes dans l'imaginaire social auparavant, sauf dans des groupuscules comme les anars effectivement, ou dans des groupuscules artistiques comme les situationnistes et les surréalistes. Castoriadis avait très bien dit, je crois (j'avais lu cela en Amérique du Sud dans un article quelque part en Argentine ou au Brésil): "68 c'est la critique de l'institution" (certes je caricature): on se rend compte qu'il y a de l'institution, qu'il n'y a pas que les gouvernements, les hommes politiques, les partis, mais qu'il y a quelque chose de plus profond encore que ça, qui nous tient au cœur et au corps, et sans laquelle nous ne vivrions pas d'ailleurs. Il n'est pas question d'en nier la nécessité; le problème est qu'il faut les changer et les bouleverser, et l'idée qu'on puisse (je traduis à ma manière) analyser l'institution comme tant d'ouvriers, de paysans, d'employés, d'étudiants l'ont fait en 68, et quelque temps après encore, sur leur lieu de travail, sur leur lieu d'activité, ça c'est quelque chose qui reste bien qu'étant beaucoup moins net et visible qu'en 68 ou même en 70.
En tant que sociologue et en tant qu'enseignant je circule pas mal dans le monde, ainsi dans d'autres pays je me rends compte que c'est réellement ça cette fibre qu'on peut appeler libertaire (mais c'est peut-être là faire trop d'honneur à certains libertaires qui n'ont peut-être pas, eux, donné l'exemple dans l'analyse de l'institution, dans la mesure où ils se sont institutionnalisés eux-mêmes, ce qui est tout à fait normal par ailleurs). Mais c'est vraiment là un héritage inaliénable, comme on dit en termes juridiques, même s'il peut être longtemps l'objet de contestations, de procès, voire même à être complètement rendu invisible, ce que nous percevons à certaines époques.
Sommes-nous vraiment pessimistes? Ce n'est pas mon cas. Il y a cette idée-là, et derrière elle, qui est générale et sociologique, il y a l'idée que l'on peut se révolter contre quelque chose (ce peut être à travers son patron, son directeur, un bureaucrate ou un organisme quelconque), cette autre idée, profondément sociologique (ce qui m'a fait dire tout à l'heure que tout le monde en ce moment-là était sociologue et que tout le monde peut le redevenir, parce que 68 a pondu des œufs qui existent encore). C'est l'importance que nous donnons (aussi bien le courant libertaire que le courant plus intellectuel dans le milieu institutionnel) à la question de l'Etat et à la critique plus que jamais nécessaire de l'Etat: dans les métamorphoses du monde en cours de mondialisation l'économique fait semblant de régner sur tout ce qui rencontre évidemment des contradictions sans arrêt et on voit que c'est absolument taux. Si la dernière crise née à Hong-Kong est en voie d'être guérie (?) c'est uniquement pour des raisons politiques et pas du tout pour des raisons économiques: il a suffi de deux phrases du président Clinton pour que le soi-disant flou économique se replie, ne déborde pas et ne vienne pas inonder la planète entière. Est donc plus que jamais en question, mais sous des formes que nous devons analyser (aussi bien les anarchistes que les sociologues de l'analyse institutionnelle), cette forme de l'Etat qui, à mesure qu'on croit qu'elle dépérit ou qu'on dit qu'il faut s'en passer ou qu'il n'en faut qu'un minimum, exprime la forme de la souveraineté. Je dirais sa forme presque mystique, à une époque où la religieuse est tout aussi important que le non religieux et où tout finit par converger sur cette question de l'Etat qui traverse toutes les institutions. Et, si on regarde par l'autre bout de la lorgnette, c'est en essayant de comprendre ce qu'est pour nous l'institution, ce jeu des pouvoirs dans lesquels nous sommes impliqués, que l'on peut saisir cette transversalité étatique, ces modus vivendi, ce "comment l'état vit, survit sur nous, en s'accrochant à nous, à nos reins jugulés comme Dracula", et cela souvent et malheureusement de façon implicite, invisible et même inconsciente, y compris chez les intellectuels qui croient être de grands sociologues et de grands politologues et qui croient avoir une connaissance des fonctionnements de la société. Voilà: c'est une grande leçon de sociologie qui reste de 68, dont je vois des traces. Même si cette leçon est loin d'être aussi éclatante et visible qu'au printemps 68. Mais le printemps et l'été continuent et reviennent périodiquement. Je ne suis absolument pas quelqu'un qui croît à la fin de l'histoire, que ce soit sur le mode néo-libéral capitaliste ou sur le mode nihiliste de gauche et d'ultragauche: je suis tout à fait étranger à cela et si j'ai été amené à penser ainsi, ce n'est pas par des origines intellectuelles spéciales, je crois que c'est vraiment grâce à la grande leçon sociologique et politique de 68.