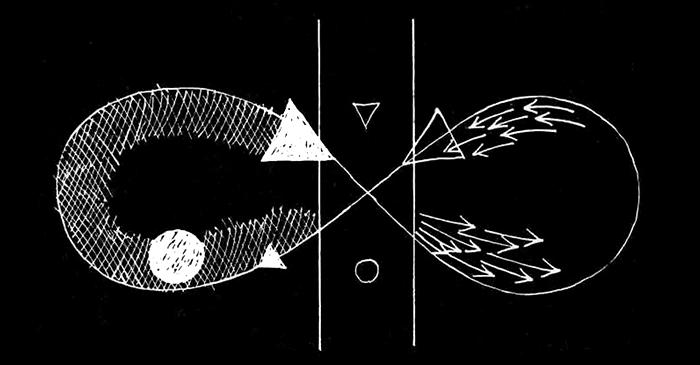Je vais me présenter: je suis Edward Sarboni, je suis militant de la FA bien entendu, et je suis actuellement depuis le 54cmc congrès de Rennes Secrétaire aux relations Intérieures. C'est une charge, un mandat que m'a confié l'organisation entre deux congrès. Par ailleurs je suis militant anarchiste sur Perpignan, c'est mon lieu de résidence et c'est là qu'avec mes compagnons et compagnes du groupe, on exerce nos talents de contestataires de la société bourgeoise, qui est installée aussi bien à Perpignan qu'ailleurs, en France ou en Europe, sous toutes les latitudes.
68, est-ce que c'est une révolution? C'est une question vaste, parce que si on dit qu'une révolution est quelque chose, un moment qui remet en cause les rapports qui sont instruits par les processus de production et par la production elle-même, 68 n'a pas modifié grand-chose. En revanche, si on considère qu'une révolution peut aussi recouvrir des transformations des mœurs et y compris sur le plan politique au sens original du terme, là on peut répondre par l'affirmative: 68 a été effectivement un moment de grande contestation.
La première de ces contestations, c'est la remise en cause par une grande partie de la jeunesse des modèles sociétaires qui étaient jusque-là imposés par les adultes. C'est bon de faire une parenthèse avec l'exemple des Etats-Unis: cette contestation qui venait des Amériques - en fait du nouveau monde- et qui depuis un certain temps, depuis la fin des années 50 et le début des années 60, remettait en cause un peu tous(tes) ces modes culturel(le)s imposé(e)s par le monde capitaliste et, en fait, quand le Mai 68 est arrivé en France, effectivement, il a été porté dans l'immédiat, je dirais, par une grande partie de la jeunesse, la jeunesse estudiantine, qui a été très rapidement relayée par la jeunesse ouvrière, la jeunesse dans les usines. Moi-même je travaillais à l'époque et 68 a été pour moi la découverte du mouvement anarchiste puisqu'avec d'autres, au hasard des manifestations qu'on faisait de manière quotidienne, j'ai commencé à voir apparaître des drapeaux noirs et donc, 68 a été un grand moment d'éveil.
Je parlais de la jeunesse: c'est important parce que Mai 68, si on considère que c'est une révolution, c'est un moment qui révolutionne les mœurs, un moment qui révolutionne, je dirais, les modes culturels et, à un moment donné, il y a une révolution aussi de l'image que se font les gens de la société dans laquelle ils vivent et de la société dans laquelle ils voudraient vivre. Par exemple: les jeunes, on en avait marre en 68, de cette société que nous proposaient les adultes, en fait une société faite de hiérarchies, de responsabilités, mais liées à des rapports, je dirais, d'autorité. Et, en fait, ils ont mis très rapidement en face des modes culturels différents. Au niveau des mœurs, il est évident qu'il y a eu une remise en cause assez profonde de la famille, des échanges interpersonnels, et on a vu effectivement émerger une contestation venant par exemple des femmes, ce qui n'existait pas jusque-là. La place de la femme dans la société s'est posée bien avant 68 mais sur les modes culturels, ça s'est posé très certainement en Mai 68. Les concepts bourgeois, concepts je dirais autoritaires qui étaient proposés par la société, par toutes les sociétés étatistes étaient remis en cause parce que, effectivement, la question qui venait très souvent comme ça à l'esprit des gens était de se dire: "A la limite on est là à travailler mais on travaille pour quoi, pour fabriquer quoi, quel style de marchandise, quel est notre place dans le processus de production, est-ce que réellement on a un poids, est-ce qu'on décide de quelque chose?". Tout ça a fait que 68, effectivement, a pris par certains aspects, un tour révolutionnaire.
Je dirais aussi (et cela me semble important, parce que bien souvent on le laisse de côté, les sociologues se sont plongés dans la question et effectivement ils ont tranché d'une manière, je dirais, un peu rapide et probablement délibérée en disant que effectivement, 68 n'était pas une révolution parce que ça ne remettait pas en cause profondément les aspects, je dirais, contestables de la société en termes de production et en termes d'exploitation), en réalité que je pense que 68 a remis en cause justement cette façon d'analyser la société: est-ce que l'homme est un homo faber comme le déterminait un peu et comme le lui assignait le marxisme (un rôle donc de contestation uniquement dans la production), ou est-ce que donc l'homme, comme disaient les anarchistes au XIXème siècle, et comme l'avait souligné Marcuse, s'installe dans une dimension d'homo ludens, c'est-à-dire qu'en fait, à côté de sa place dans la production, il y a aussi ses désirs, sa volonté de vivre, sa volonté de vivre des passions, éventuellement sa volonté de vivre des passions dans des rapports avec d'autres, et ça, c'est probablement, je dirais, le point fort, le point d'ancrage de 68. A partir de là, on ne peut pas regarder les choses comme avant, et ça c'est important.
Quand on parle de 68, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit: en l'occurrence, je peux dire que cela vient à l'esprit de pas mal de compagnes et de compagnons, c'est vrai qu'on a une question qui vient donc rapidement et c'est que 68 est effectivement une révolution, et à côté de cela, je pense qu'on peut affirmer que si 68 est une révolution, dans la mesure où elle met en cause des processus culturels au niveau des échanges, au niveau des mœurs, au niveau de la place des individus dans la société, elle est une révolution intimement libertaire au sens large.
Ceci étant, il y a une autre question qui vient à l'esprit: est-ce que les anarchistes sont les protagonistes de cette révolution, ou est-ce qu'ils la suivent ou, éventuellement, est-ce qu'ils la subissent? Qu'ils la subissent, je ne le pense pas. Mais les anarchistes ont fait comme tout le monde: ils l'ont vue arriver. Je ne pense pas qu'ils l'aient prévue, pas plus que quiconque, mais ils ne l'ont pas subie, au sens où réellement 68 reprenait des idées, des convictions intimes de ce mouvement-là; donc ils ne pouvaient pas la subir. Evidemment qu'ils n'en ont certainement pas été les protagonistes, c'est vrai. En revanche, il reste une solution, je dirais, un niveau: c'est que les anarchistes l'ont suivie et l'ont suivie en essayant de mettre, d'amener, de porter, au moment opportun et dans les lieux opportuns, des discours, des propositions anarchistes effectivement pour aider un peu à cette volonté, je dirais, globale, de comprendre la société dans un nouvel esprit et d'essayer de proposer des solutions nouvelles pour la société future.
Les anarchistes ont pris cette place-là. Mais en revanche, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et on n'a rien dit. Est-ce qu'organisationnellement les anarchistes et les mouvements anarchistes étaient prêts à assumer ces mouvements de 68? Je pense que non. Pourquoi je dis non? Parce que, si on pose la question "étaient-ils prêts de manière organisationnelle?", "est-ce que les moyens de propagande, est-ce que les moyens qui permettaient à ce qu'une révolution qui se mettait en marche prenne de l'ampleur, est-ce que donc ces moyens-là étaient dans les mains des anarchistes?": sincèrement, non.
Si on me posait la question: est-ce que les moyens de la réflexion et les propositions anarchistes étaient importants, suffisants: oui. Mais le problème c'était probablement de donner de l'ampleur, de l'écho â des revendications qui émanaient de la base, au sens profond du terme, des individus qui commençaient à prendre la parole; 68 est un moment intense de prise de parole par les individus et donc les anarchistes étaient organisés.
Si je me réfère à des sigles d'organisations, en 68 il y avait la FA qui existaie depuis 1954-55 et qui avait un organe de presse qui était mensuel à l'époque, Le Monde Libertaire, mais c'est le même journal, la même organisation qui ont évolué, et puis il y avait l'ORA qui existait déjà mais comme une organisation révolutionnaire anarchiste à l'intérieur de la FA: elle n'existait pas encore en tant qu'organisation, je dirais, réellement. Et puis il y avait une kyrielle de petites organisations comme on a toujours connu, et comme on connaîtra toujours dans le mouvement libertaire. Mais en réalité ce qui est important, au niveau anarchiste, était là. Ces organisations étaient effectivement très minoritaires dans la classe ouvrière, très minoritaires dans le pays. Je répète: elles ne l'étaient certainement pas par rapport aux propositions qu'elles faisaient, mais elles l'étaient numériquement et elles l'étaient au-delà de cet aspect numérique, dans la capacité qu'elles avaient à pouvoir faire changer les choses.
Pour donner un exemple: en 68 on avait un mensuel -un hebdomadaire, c'est déjà très difficile à gérer, mais ça peut donner un certain nombre d'éclaircissements sur des situations précises-. Un mensuel, ça ne peut intervenir que sur le fond, sur l'idéologie, ou la proposition fondamentale, rarement sur les incidences de tel ou tel aspect d'une lutte. On n'avait pas un quotidien, on avait un mensuel, et donc... Je n'étais pas à la FA à l'époque, je n'étais pas dans le mouvement anarchiste à l'époque, j'y suis venu en 68, profondément, parce que, malgré tout, 68 a permis que des gens arrivent, adhèrent à ces idées, et adhèrent à ce mouvement. Mais, je répète, organisationnellement, on n'avait pas ces capacités-là.
Un autre exemple, c'est Radio-Libertaire. Si je me remémore les choses telles qu'elles se passaient, en 68 les radios (et alors je pense à RTL, Europe 1) faisaient - et ça explique un peu le sens profond de Mai 68 - pratiquement comme de la radio libre, ce qu'on a connu par la suite, à savoir que les producteurs de l'information, les hommes de radio qui se trouvaient dans la rue, pas tous très âgés (il y avait déjà des jeunes, en fait des jeunes femmes, des jeunes hommes), ont été happés par l'ampleur du mouvement, par son intensité et en fait ils faisaient de la radio libre avant la lettre, sans qu'il y ait une censure pré-établie, sans qu'ils aient le flic dans la tête et, en fait, on avait des discussions à la radio -aux radios officielles-entre un recteur et Cohn-Bendit, ou Sauvageot, ou Geismar, qui étaient les représentants un peu en vue du mouvement étudiant. Ga c'était spécifique.
Je veux dire là que si nous avions eu Radio-Libertaire, mais quel formidable outil! Parce que nous aurions eu, en fait, la vraie radio au bon moment. C'est-à-dire la radio qui n'aurait pas, je dirais, fait office de béquille à un mouvement qui demandait justement cette parole, mais qui l'aurait donnée, cette parole, parce qu'intimenment, la radio de la FA, Radio-Libertaire et toutes les radios libertaires de par le monde, quand elles donnent la parole, ce n'est aps uniquement pour qu'on la prenne, mais c'est pour que cette parole subvertisse la société en profondeur. Là, les journalistes d'Europe 1, de RTL, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tout simplement ils mettaient de la subversion dans leur boulot, mais pas dans la société. En fait c'était dans la forme que les choses se passaient, mais pas dans le fond (!!!). Donc, voilà, je pense, deux ou trois éléments qui nous permettent de dire que 68 a trouvé tous les anarchistes pour dire "présent!", mais on n'a pas trouvé le mouvement, si tant est que certains le cherchaient, ou on n'a pas trouvé le mouvement qui permettait d'amplifier ce qui était en train de se mettre en marche. Je pense que ça, l'histoire l'a quand même fait valoir.
Que, dans les livrées sur 68, écrits par des historiens, des sociologues, y compris par les acteurs, les actrices, on relativise la place que nous avons eue, nous, anarchistes, je pense que c'est très logique, c'est une question d'éthique et d'humilité. On a mis tous les moyens qu'on avait à l'époque, on ne pouvait pas plus. On le regrette bien sûr, mais on a mis tout ce qu'on avait comme moyens.
En revanche, je pense qu'il y a pas mal de courants politiques qui s'arrogent 68, mais là c'est une autre histoire, on ne va pas parler de ça: ils se l'arrogent à tort.
Tu vois, on a essayé de définir "mon 68" (révolution, pas révolution), après j'ai apporté ce supplément d'information sur la place des organisations.
Dans la réalité de l'apport de ces organisations anarchistes en mai 68, je pense que, pour tenter d'être complet, si on peut l'être, il est important de parler d'un phénomène, parce qu'il reprend les éléments de l'intervention des anarchistes (chose que j'ai essayé d'étayer un peu), et puis a reprend aussi en compte des éléments qui étaient dans la première partie de ce que je disais, à savoir 68, on peut le considérer comme une révolution si on s'arrête à un certain nombre de spécifications. Je veux parler du mouvement des communautés.
Des communautés libertaires, parce que je pense qu'il faut appeler un chat un chat: c'était des communautés libertaires, lesquelles ont commencé à s'établir à partir de 68 et je pense (j'ai fait une étude d'histoire là-dessus) qu'on peut dire que de 68 à 78, sur une dizaine d'années, on est effectivement confrontés à un phénomène de mise en place de collectifs, de collectivités de type anarchistes ou de type libertaire. Et je pense qu'avant même d'entrer en matière, dans le détail de cela, il est important de dire que, dans la mesure où on considère que 68 a soulevé des questions de remise en cause de modes culturels et de modes de communication interpersonnels, la réponse, et pratiquement la réponse unique à ce mouvement-là et l'une de ses suites, est totalement impliquée dans le mouvement des communautés libertaires. Dire cela c'est une évidence. Mais, à ce moment-là, il faut quand même regarder enfin, retourner la tête et mettre le regard sur le passé: est-ce qu'il y a reu des tentatives de construction, de mises en place de communautés anarchistes? Il y en a une qui nous éclaire: c'est la Cécilia, qui est au Brésil, et où des compagnons anarchistes ont fait fonctionner de manière libertaire, de manière collective, une vie, un quotidien, et ceci pendant des mois. Cet exemple-là nous conduit à penser que, quand les communautés vont s'établir, surtout dans le sud de la France (globalement dans le sud-ouest, mais il y en a eu d'autres dans les Cévennes, et on en trouve aussi dans les Alpes de Haute-Provence et en Provence), quand ces communautés vont d'établir par-là, on ne peut pas penser, à aucun moment, qu'elles n'ont pas connaissance de ce qui s'est fait auparavant, c'est-à-dire qu'il est là question de parler de la mémoire de ce que nous enseigne l'histoire, et donc effectivement, les communautés anarchistes libertaires qui ont existé de par le monde, notamment en France, au début du XXème siècle et jusque dans les années 20 (...), ont laissé des traces et ont permis, je dirais, à de jeunes contestataires de 68 de mettre en adéquation la contestation qu'ils portaient de la société et une pratique au quotidien.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis, pour l'essentiel, ils ont quitté leur domicile, c'est-à-dire qu'ils quittaient le modèle familial et le contestaient dans ce sens qu'ils ne voulaient pas créer ailleurs ce modèle. Cette contestation touchait l'individu, non pas du point de vue, je dirais, sexué, mais était totalement éclatée, c'est-à-dire que, quand arrivaient des gens en communauté, des individus en communauté, femme ou homme, la question ne se posait pas. Ces individus-là voulaient être les protagonistes de leur propre vie, si bien qu'un deuxième tabou était en quelque sorte très rapidement subverti: c'était la question du couple dans un premier temps et dans un second temps, je dirais, ce qui est souvent lié, la question de la propriété: "ma" femme, "mon" mari, "mon" mec, "ma" nana. Effectivement, à proposition nouvelle, façon d'agir nouvelle et les difficultés pouvaient l'être, mais en tous les cas, on voyait deux niveaux de remise en cause.
Un troisième niveau de remise en cause était dans ces communautés le fait que l'argent qui était amassé, si tant est qu'on puisse dire ça, pouvait venir de sources différentes: quelques-uns ou quelques-unes dans la communauté pouvaient travailler à l'extérieur - vous voyez qu'il n'y avait pas une totale césure avec le monde capitaliste parce que ces gens-là subissaient l'exploitation -, mais en tous les cas, ce qu'ils pouvaient en tirer - les salaires -, ils pouvaient l'amener dans la communauté, et, à ce moment-là, cette part financière, économique, qui arrivait dans la communauté, permettait de mettre en place tout autre chose. Bien évidemment ce n'était pas pour pérenniser ou pour continuer la société capitaliste, mais c'était pour la contester dès à présent dans le quotidien.
Et puis il y avait d'autres façons de faire rentrer de l'argent dans la communauté: effectivement la production des communautés elles-mêmes: c'était de l'autoproduction. Alors elles pouvaient s'établir sur le plan agricole. Il faut avouer que cela a rarement fonctionné. Ça pouvait être sur le plan artisanal. Tout ce qui a pu se faire à l'époque - soit la fabrication de vêtements, de bijoux, d'objets de cuivre, sacs - enfin tout ce qui était artisanal et qui pouvait établir un nouveau mode de production qui n'était pas du tout pris en tenailles par l'Etat.
Ces styles d'interventions, effectivement, tendaient à ajouter une autre dimension dans la mise en place de la communauté d'esprit communautaire: on met en commun un certain nombre de finances, des choses diverses, mais cette gestion est commune et il n'est pas question que la personne qui apporte sa contribution puisse avoir un pouvoir quelconque ou un rôle hiérarchique quelconque du fait qu'elle a amené tant ou tant. Il y avait là un nouvel aspect aussi: c'était le fonctionnement très égalitaire dans sa volonté, à l'intérieur de la communauté. On pourrait multiplier les exemples, j'en ai un autre qui est à nouveau culturel et de modes de relations. Il est dit, dans énormément de communautés que les enfants d'un couple devenaient quelque part les enfants de la communauté, à savoir que l'éducation des jeunes enfants n'était pas l'apanage des parents, parce que sinon ça devenait la reproduction du modèle familial de toutes les sociétés étatistes capitalistes et patriarcales. Mais là nous avions un nouveau mode de production des échanges interpersonnels. 11 faut le dire honnêtement, toute cela a été proposé et s'est déroulé dans les communautés. Est-ce qu'il y a eu des résultats tangibles? Je pense que, déjà, si on posait la question comme à-ça, on peut dire oui: effectivement, ça a éveillé pas mal de contestations individuelles et collectives chez les gens qui étaient dans les communautés et même au-delà des communautés, puisque ces communautés s'établissaient dans des endroits précis et je pense que les villageois ou les gens des villes (il y avait aussi des communautés urbaines) qui voyaient "ces gens-là", ces communautaires, ces collectivistes (ils les appelaient "ces hippies" à la campagne, en Ariège c'était "ces chevelus", ces "beatniks" -on voit là tous ces qualificatifs), vivre et "s'éclater" (ne pas être triste c'est quand même important) et puis amener (parce que ce n'était pas uniquement que ludique) des aspects contestataires par rapport à la vie en société (des gens qui ne produisaient pas obligatoirement un modèle complètement détaché des gens qui vivaient à côté d'eux - je veux dire par là les communautaires qui tentaient de rencontrer les autochtones, les gens des villages, des villes dans lesquels ils étaient venus s'installer), tout ça a fait que, effectivement, les communautés ont eu à coup sûr des retombées.
J'en vois une. Je pense que la contestation féministe est née là. Je veux dire qu'en fait dans le modèle communautaire la femme devient un individu à part entière sous tous les aspects des échanges avec les autres individus, à savoir dans les rapports, je dirais, amoureux, dans les rapports à l'enfant, même dans le collectif et dans le rapport au fonctionnement matériel, économique d'une entité collective et donc, à partir de là, ça a dû susciter, je suppose, cette volonté de traduire au travers d'un mouvement authentiquement féminin, authentiquement féministe, cette contestation. Pour le reste, il est évident qu'entre 68 et 78, beaucoup de communautés ont existé et, du reste, elles se sont rencontrées, des rencontres concernant les communautés se revendiquant de l'anarchisme. Il faut préciser là que le mode des communautés anarchistes est un mode fort important. Dans Le Monde, une étude du début des années 70 donnait une statistique: à peu près 100000 personnes vivaient dans des communautés en été. Il est évident que la période estivale était une période intéressante parce qu'elle permettait à des gens qui habitaient dans le Nord de la France et éventuellement de l'Europe, de venir dans le sud, d'accord, mais, en tous les cas, quand l'hiver rigoureux arrivait, les gens restaient. Si bien qu'on ne peut pas répondre de manière définitive en disant "bon, c'était tout simplement une façon de passer les vacances au chaud et à peu de frais", non: il y a eu réellement un mouvement profond, un mouvement des communautés large qui, à un moment donné, a été l'émanation concrète de ce que pouvait porter 68.
Est-ce que ce mouvement, après 78 (j'accorde une décennie de développement avec des pointes et des chutes pour des moments d'avancée et de recul), a continué? Je pense qu'il a continué sous d'autres formes: on est passé des communautés libertaires ou des communautés anarchistes à un autre mode de fonctionnement qu'on a appelé "alternatif" et donc, on a appelé les gens "les alternatifs". Dans la mesure où il est question de 68, ce là touche à la remise en cause des valeurs bourgeoises, par exemple, il s'est agi très souvent de la façon d'appréhender, par exemple, la délinquance ou la déviance en société. Le courant des compagnons italiens (mais il y avait cette préoccupation là aussi en France, en Allemagne, dans pas mal de pays en Europe et même aux Etats-Unis -je parle des italiens parce qu'ils étaient assez en avance là-dessus) apportait un certain nombre de réponses quant au traitement de ces problématiques de la "déviance" en société, et ça s'est posé aussi justement dans la pratique des communautés.
Dans la région de Nîmes par exemple il y avait une communauté où les gens qui vivaient accueillaient un certain nombre de gens qui vivaient une éd "viance" et donc la communauté, au-delà de sa spécificité propre, gérait autre chose. Je dirais qu'elle devenait un lieu de résolution d'autres problèmes. Je ferme la parenthèse pour dire qu'en fait c'est quelque chose qui est resté après 78.
On a vu ce qu'on appelait "des lieux de vie" et les "lieux de vie sont nés, on peut dire, de cette tradition de 68 et de cette tradition de communauté, à savoir qu'à un moment donné, on mettait une microsociété non plus pour qu'elle dise "on peut vivre en microsociété" mais pour qu'elle établisse une base où les rapports interpersonnels devenaient des rapports totalement libérés, pour ne pas dire libertaires, qui permettaient sur le plan thérapeutique, je dirais -avec tous les guillemets qu'on peut mettre- de "gérer" justement des "déviances" ou des cas qui ne pouvaient pas être pris en compte dans la société telle qu'elle est et telle que nous la connaissons. On voit quand même que, par effet de boucle, par effet d'un écho, 68 va très loin. Je pourrais dire pour finir que le fait qu'on en parle encore - d'accord c'est il y a 30 ans mais je pense que c'est aussi parce que 68 était aussi une lame de fond, que c'était profond et qu'on n'a pas fini de’en découvrir les traces, les marques que ça a pu laisser chez les individus -, moi je dis "tant mieux" parce que ça a permis une libération des individus et si, pour les étatistes de tout poil, c'est un mal, pour nous, militants anarchistes, je pense que c'est un bien.
Ces traces de 68, ces marques de 68, feront des petits encore longtemps et, au-delà des anniversaires, ce qui compte, c'est la trace chez les individus. Je ne pense pas qu'une jeune femme aujourd'hui puisse réfléchir à un certain nombre de problèmes ou envisager un certain nombre de problèmes comme elle le faisait avant.
Il y a un avant 68 et il y a un après 68 et c'est tant mieux.